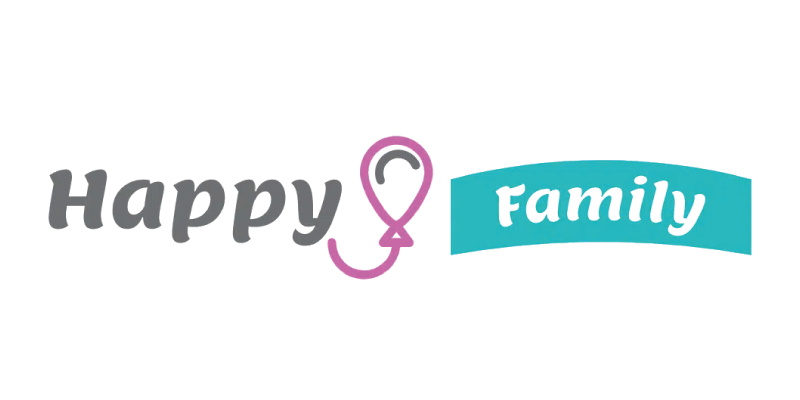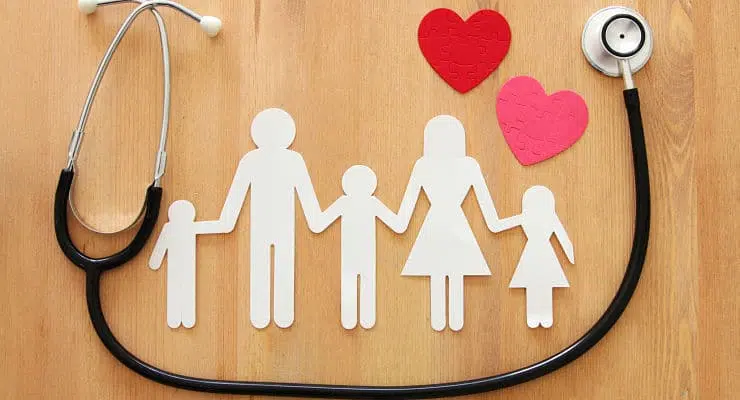Certains textes traversent les siècles comme des énigmes jamais résolues, toujours promptes à raviver la flamme du débat. « La cigale et la fourmi » ne déroge pas à la règle : sous ses allures de comptine limpide, la fable de La Fontaine reste un terrain de jeu pour interprètes de tout poil. Morale fluctuante, détournements en cascade, analyses enfiévrées, depuis 1668, rien n’a apaisé la controverse. L’histoire paraît simple : deux protagonistes, une leçon. Mais à mesure qu’on la relit, elle se dérobe, se recompose. Et si son pouvoir résidait justement dans cette résistance à l’univoque ?
Pourquoi « La cigale et la fourmi » fascine-t-elle toujours petits et grands ?
C’est une histoire qu’on apprend à l’école, qu’on récite en famille, qu’on cite dans les conversations sans même s’en rendre compte. La fable de La Fontaine, écrite il y a plus de trois siècles, s’est incrustée dans la culture française, au point de devenir un repère. Mais pourquoi ce récit continue-t-il de captiver ? Peut-être parce qu’il croise l’évidence de la narration à la profondeur des thèmes abordés. Deux personnages, deux visions du monde : la cigale, insouciante, et la fourmi, méthodique. L’opposition saute aux yeux, mais elle ne se fige jamais vraiment. L’histoire parle de travail, de plaisir, de mérite, de justice sociale : autant de notions que chaque époque, chaque génération, réinterprète à sa manière.
Les racines du texte puisent dans des sources anciennes, Ésope, mais aussi d’autres fabulistes comme Gilles Corrozet ou Isaac de Benserade. Pourtant, La Fontaine y injecte une modernité singulière. En donnant la parole aux animaux, il abolit la distance entre le lecteur et l’objet de la leçon. On s’identifie tour à tour à la cigale ou à la fourmi, selon son humeur ou son parcours de vie. Ce jeu d’identifications multiples explique sans doute l’étonnante longévité de la fable.
Au fil des siècles, la cigale et la fourmi se sont invitées partout : dans les manuels scolaires, sur les scènes de théâtre, dans les essais philosophiques. Rousseau s’en empare pour interroger l’éducation, Jacques Lacarrière pour disséquer la morale. Les artistes et pédagogues s’en donnent à cœur joie, détournant la fable pour défendre l’art, critiquer l’égoïsme ou prôner la solidarité. Voilà pourquoi, malgré le temps qui passe, cette histoire continue d’attiser la curiosité, la discussion et la réflexion.
Le texte original : une lecture vive, pleine d’ironie
En vingt vers, La Fontaine installe un univers où chaque mot fait mouche. L’alternance des heptasyllabes et des alexandrins donne un rythme nerveux, presque théâtral, qui évite toute lourdeur. La magie de la personnification opère : la cigale devient artiste sans filet, la fourmi gestionnaire impitoyable. À travers le dialogue direct, le lecteur assiste à l’affrontement, la célèbre réplique de la fourmi résonnant comme un couperet : « Vous chantiez ? J’en suis fort aise. Eh bien ! dansez maintenant. »
La Fontaine maîtrise l’art de l’allégorie et de l’anthropomorphisme : il prête aux animaux des attitudes, des faiblesses, des orgueils profondément humains. Mais il se garde bien de tout dogmatisme. Nulle morale martelée, aucun sermon. Il préfère laisser le lecteur conclure, semant le doute plus qu’il ne distribue des certitudes. Cette discrétion donne toute sa puissance au texte : chacun peut y lire ce qu’il veut, selon son parcours, son âge, ses convictions.
Voici quelques traits distinctifs du texte qui expliquent son efficacité :
- Une versification qui donne du souffle et de la tension à la scène
- Des personnages animaux qui prêtent à sourire mais portent des enjeux très humains
- Une morale qui n’est jamais assénée, mais suggérée, presque chuchotée
L’humour s’infiltre subtilement : on sent la tendresse pour la cigale, la distance amusée face à la fourmi. Le lecteur, pris entre admiration pour la rigueur et empathie pour l’insouciance, reste libre de choisir son camp, ou de n’en choisir aucun. C’est là, sans doute, que réside la modernité de La Fontaine : dans cette invitation à penser, à douter, à discuter.
Deux personnages, deux visions de la vie : quelles leçons en tirer ?
La fable oppose deux mondes, deux philosophies. D’un côté, la cigale : figure de l’artiste, elle vit dans la spontanéité, la joie immédiate, le partage. Elle incarne le goût du présent, la confiance dans l’instant, quitte à affronter le froid sans ressources. De l’autre, la fourmi : symbole de prudence, elle accumule, planifie, prévoit. Le travail, l’épargne, la discipline sont ses horizons. Mais à trop vouloir se protéger, la fourmi ne bascule-t-elle pas dans l’égoïsme ?
Pour mieux comprendre ce contraste, voici ce que chacun incarne :
- La cigale, artiste généreuse, fait passer la création et la convivialité avant la prévoyance
- La fourmi, gestionnaire avertie, privilégie l’ordre, la sécurité, parfois au détriment de l’empathie
Entre ces deux pôles, la fable interroge sans relâche : où placer le curseur entre plaisir et devoir, entre altruisme et prudence ? La Fontaine ne donne pas de réponse toute faite. Selon l’époque, selon les valeurs du moment, la balance penche tantôt vers la cigale, tantôt vers la fourmi. Aujourd’hui encore, ce dilemme nourrit les débats : faut-il privilégier la création ou la sécurité ? La solidarité ou l’intérêt individuel ? Cette tension continue de hanter les discussions sur la place du travail, la reconnaissance de l’art, la frontière entre prévoyance et repli.
De la morale classique aux lectures contemporaines : une fable qui interroge toujours
La morale de « La cigale et la fourmi » a traversé les âges sans jamais figer son sens. Longtemps, on y a vu une ode à la prévoyance, un éloge du travail bien fait. Mais La Fontaine, fidèle à sa subtilité, ne condamne jamais explicitement la cigale. Il préfère l’ambiguïté : faut-il vraiment lui reprocher sa légèreté ? Peut-on glorifier sans nuance la sévérité de la fourmi ?
Ce flottement a permis à la fable d’être réinterprétée à l’infini. Les écrivains, de Pierre Perret à Raymond Queneau, s’en sont emparés pour la détourner, la parodier, la mettre en musique ou en images. Gustave Doré, Benjamin Rabier, Jacques Offenbach, Camille Saint-Saëns… Tous ont proposé leur version, oscillant entre tendresse, ironie et critique sociale. La cigale et la fourmi deviennent alors autant d’écrans pour réfléchir à la société, à la solidarité, à la place de l’art.
De nos jours, la fable s’invite dans des domaines inattendus. Elle sert de support à des campagnes de santé publique, d’illustration à des débats sur l’agroécologie, de point de départ à des discussions sur la gestion des ressources. Sa capacité à susciter des interprétations multiples, son ancrage dans l’intertextualité, la rendent toujours pertinente. Entre la tentation du repli et l’appel du collectif, entre le souci de l’avenir et la célébration du présent, la fable continue d’ouvrir le champ des possibles. Comme un miroir tendu à chaque époque, et à chacun d’entre nous.