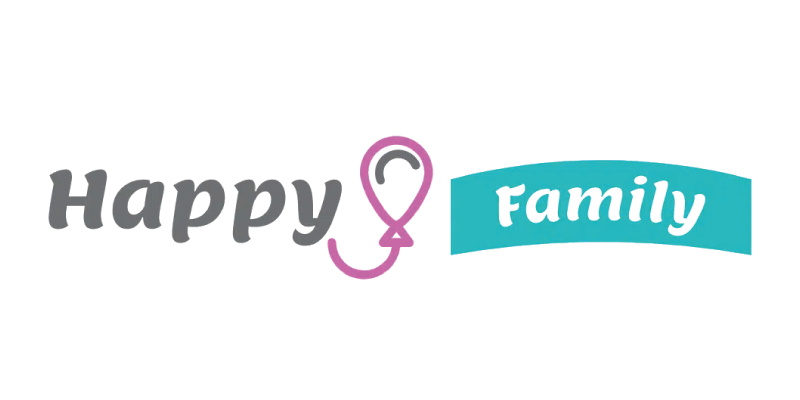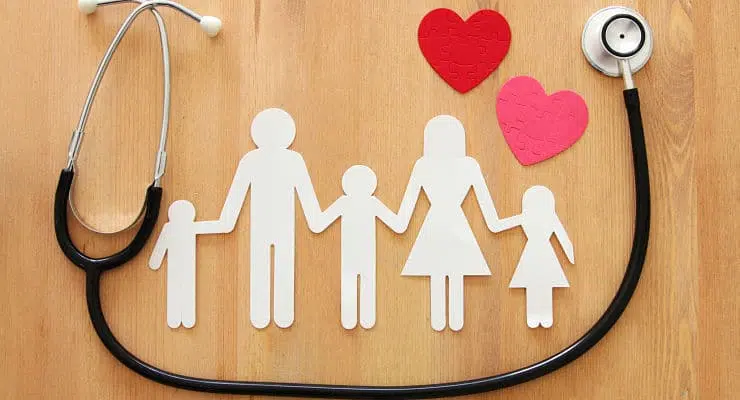17 % : c’est la part des femmes dans les comités exécutifs des grandes entreprises françaises. Les lois changent, les chiffres bougent, mais la réalité du terrain ne suit pas toujours le rythme.
Depuis 2022, toute entreprise de plus de 50 salariés doit publier un index d’égalité professionnelle sous peine de sanctions financières. Pourtant, le constat est net : moins d’une structure sur deux joue le jeu. Du côté de la fonction publique, la féminisation atteint 62 %… mais les postes de décision restent largement aux mains des hommes, qui occupent encore 67 % des responsabilités les plus hautes.
Des mesures concrètes sont désormais en place : prévention des risques professionnels, lutte contre les écarts de salaire, accès facilité à certains droits. De nouveaux textes législatifs soutiennent cette dynamique. Mais, sur le terrain, la réalité est plus contrastée : beaucoup d’initiatives attendent encore de franchir le cap de l’application pour produire des résultats tangibles.
Où en est l’égalité professionnelle entre femmes et hommes aujourd’hui ?
La notion d’égalité professionnelle sonne familièrement dans les discours et les textes depuis quarante ans, mais l’écart avec la pratique reste flagrant. La loi de 1983 a posé la première pierre vers la réduction des différences de salaire entre femmes et hommes. La parité a été inscrite dans la Constitution dès 1946, mais le plafond de verre ne s’est pas effrité pour autant. On compte toujours trop peu de femmes dans les directions ou les conseils d’administration, malgré la loi Copé-Zimmermann et ses quotas imposés.
Depuis 2019, l’Index Égalité s’impose à toutes les entreprises d’au moins 50 salariés. Chaque année, elles doivent publier leur note, établie sur plusieurs critères : écarts de rémunération, accès aux augmentations ou promotions. Un score de 75/100 s’impose comme seuil minimum : en dessous, des sanctions tombent. Pourtant, l’obligation est loin d’être systématiquement appliquée. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 28,1 % des femmes travaillent à temps partiel, contre 7,6 % des hommes, selon l’Insee.
Pour mieux situer ces avancées, voici trois repères-clés :
- Le droit de vote pour les femmes en 1944
- L’inscription de l’égalité femmes-hommes dans la Constitution en 1946
- L’Index Égalité rendu obligatoire depuis 2019
Les statistiques révèlent l’ampleur du chemin à parcourir. Aujourd’hui, 40 % des membres des conseils d’administration des grandes entreprises sont des femmes : il a fallu dix ans de quotas pour franchir ce seuil. Mais l’accès aux postes les plus stratégiques reste verrouillé. Selon l’Insee, les femmes continuent de percevoir en moyenne 15 % de moins que les hommes pour un poste équivalent. Rendre public l’Index Égalité n’est qu’un outil parmi d’autres, qui n’a de force que si entreprises et pouvoirs publics s’engagent à en faire un véritable levier de changement.
Les lois récentes qui changent la donne pour les femmes au travail
La loi Copé-Zimmermann de 2011 a posé une étape décisive, imposant des quotas dans les conseils d’administration des grandes entreprises : objectif, 40 % de femmes en six ans. Cette cible est désormais atteinte, et marque une transition dans la gouvernance. Pourtant, cette progression concerne surtout les conseils d’administration, moins les comités exécutifs, où les femmes restent minoritaires.
La loi du 4 août 2014 a poursuivi cette dynamique en agissant sur plusieurs fronts :
- l’accès à l’emploi,
- l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle,
- la lutte contre les stéréotypes,
- l’égalité des salaires.
Ce texte impose désormais aux entreprises d’ouvrir des discussions sur l’égalité professionnelle, renforçant la pression sur les employeurs pour faire avancer les choses.
En 2018, une nouvelle étape a été franchie : la loi du 3 août cible spécifiquement les violences sexuelles et sexistes dans le monde du travail. Elle crée l’infraction d’outrage sexiste, allonge les délais de prescription pour les crimes sexuels sur mineurs et renforce la protection des victimes. L’objectif est clair : garantir à chacun et chacune un environnement de travail sûr et respectueux.
La loi du 19 juillet 2023 ajoute une pièce maîtresse à cet édifice en étendant l’Index Égalité professionnelle à la fonction publique. Désormais, les établissements publics doivent eux aussi rendre publics des indicateurs sur les écarts de rémunération, les promotions et le temps de travail. Cette transparence donne aux agents un outil de comparaison et pousse les administrations à progresser, là où les disparités restaient parfois invisibles.
Fonction publique : chiffres clés, garanties et défis persistants
Petit à petit, la fonction publique se conforme aux exigences d’égalité imposées au secteur privé. Depuis 2023, l’index de l’égalité professionnelle concerne tous les établissements publics, avec publication annuelle des résultats à la clé. Ce mouvement oblige les administrations à révéler les écarts existants, qu’ils concernent les rémunérations, les promotions ou l’accès aux postes de direction.
Quelques données illustrent cette dynamique et ses limites :
- En 2024, le ministère de l’Intérieur affiche un score de 80/100 à l’index, signe d’un progrès, mais aussi d’un potentiel d’amélioration.
- Certains ministères obtiennent la labellisation AFNOR Égalité professionnelle et diversité, preuve d’un engagement réel.
Le plafond de verre reste solide : les femmes sont encore peu nombreuses parmi les cadres supérieurs et les hauts dirigeants des établissements publics. Les chiffres issus de la BDESE (base de données économiques, sociales et environnementales) montrent des écarts persistants, en particulier en ce qui concerne le temps partiel, qui touche davantage les femmes dans l’administration comme ailleurs.
Les dispositifs de protection et d’accompagnement se multiplient : chaque CSE d’établissement public doit désigner un référent harcèlement sexuel. Le Défenseur des droits surveille la protection des salariées, tandis que la Direccte aide les établissements à calculer leur index. Mais, d’une administration à l’autre, la mise en œuvre varie. Certaines structures progressent, d’autres freinent, révélant des blocages profonds et des inégalités bien ancrées.
Santé, droits, accompagnement : zoom sur les programmes qui font la différence
L’accès à la santé reproductive reste central dans le combat pour l’égalité. La légalisation de la contraception en 1967 a permis aux femmes de disposer de leur corps, vite suivie par la loi Simone Veil de 1975, qui autorise l’interruption volontaire de grossesse (IVG). Ces avancées constituent l’ossature des droits des femmes, régulièrement consolidés face aux tentatives de remise en cause. Aujourd’hui, les sages-femmes sont de plus en plus mobilisées pour accompagner les femmes lors de l’IVG, ce qui contribue à rendre l’offre de soins plus accessible partout en France.
En matière de violences sexistes et sexuelles, l’État s’appuie sur un réseau d’acteurs engagés, comme le CIDFF (centre d’information sur les droits des femmes et des familles), qui accompagne chaque jour des victimes, notamment en Provence-Alpes-Côte d’Azur. La DREES fournit des enquêtes régulières sur les stéréotypes de genre, offrant des données précieuses pour ajuster les politiques publiques et mesurer les résistances culturelles.
Autre priorité : l’accompagnement face à la précarité. Pour lutter contre les impayés de pension alimentaire, des dispositifs spécifiques ont été mis en place afin d’aider les mères isolées et de renforcer la sécurité des familles les plus exposées. À l’école et dans l’enseignement supérieur, des initiatives comme l’opération Ingénieuses de la CDEFI ou le concours Générations Égalité de la CGE s’attaquent aux stéréotypes dès le plus jeune âge, invitant les jeunes filles à investir les filières scientifiques. L’engagement de personnalités comme Sylvie Retailleau contribue à donner de nouveaux modèles et à ouvrir la voie aux générations suivantes.
Des lois, des chiffres, des visages : l’égalité se construit sur le fil du quotidien, entre avancées concrètes et résistances tenaces. Le prochain chapitre s’écrira avec celles et ceux qui refuseront de s’en satisfaire.